
 |
La Psychanalyse peut-elle encore être utile à la psychiatrie ? |
La Psychanalyse peut-elle encore être utile à la Psychiatrie ?
Cette question est aujourd’hui centrale. Elle constitue le titre de
l’ouvrage que Guy Darcourt vient de publier. PLR a
souhaité contribuer à la réflexion qu’il nous propose.
C’est par un entretien avec l’auteur que nous ouvrons ce numéro.
Plusieurs points majeurs y sont abordés, tels que la façon dont
le DSM, utilisé hors de son champ de compétence, a privilégié l’approche
de surface aux dépens de l’investigation clinique, ce que recouvre
une approche psychiatrique psychanalytique, la situation actuelle de l’hystérie,
de la perversion et des états limites. Une véritable et constructive
discussion autour de la clinique.
Cinq autres cliniciens, qui ont également une charge d’enseignement
auprès des futurs psychiatres ou psychologues, ont été sollicités
pour aborder notre question thématique autour de trois axes privilégiés
: la psychopathologie, la thérapeutique et la recherche. Aucun ne nie
que la psychanalyse est « encore » utile à la
psychiatrie, cependant ils ne parlent pas d’une seule voix pour le postuler.
Philippe Cialdella insiste sur la complexité de la
psychiatrie et la nécessité d’apports multiples. La psychanalyse
est l’un d’eux. Elle est un outil qui explique, mais dont l’efficacité ne
lui semble pas assez visible dans le domaine des psychoses par exemple. Elle
représente néanmoins un modèle pertinent pour écouter
tous les types de demandes et de problématiques des patients reçus
en libéral.
Pierre-Henri Castel, pense que le mouvement « anti » psychanalyse
est en train de repartir dans l’autre sens, mais qu’il faudra
compter avec une approche psychiatrique sociale, « lieu naturel
d’interactions psychodynamiques fortes ».
Julien Daniel Guelfi répond aux trois questions en
ciblant là où la psychanalyse est pour lui un outil pour penser,
comprendre et qui permet d’aller au-delà des comportements et
d’imaginer les mécanismes psychiques qui les sous-tendent.
Bernard Golse se sent irrité par la question même.
Comment aborder la thérapeutique de l’enfant par exemple, en
faisant l’économie de son histoire et de ses troubles ?
Nicolas Georgieff pose qu’il est essentiel de réfléchir
aujourd’hui comment la psychanalyse s’articule aux autres approches
dans une psychopathologie plurielle.
C’est un échange passionnant et ouvert aux réflexions d’aujourd’hui
dans un climat devenu trop polémique (trop politique ?). Chacun
prend sa place dans le débat à partir de son environnement clinique
sans faire abstraction des progrès scientifiques.
Un deuxième volet de ce numéro concerne le tout nouveau « Manuel diagnostique psychodynamique » (Psychodynamic Diagnostic Manual- (PDM)). Il est une autre forme de réponse à la question de l’utilité de la psychanalyse pour la psychiatrie. Daniel Widlöcher fait une présentation générale du volume, François Sauvagnat en présente la partie dédiée à la psychopathologie de l’enfant et Jean-Michel Thurin celle qui porte sur la recherche
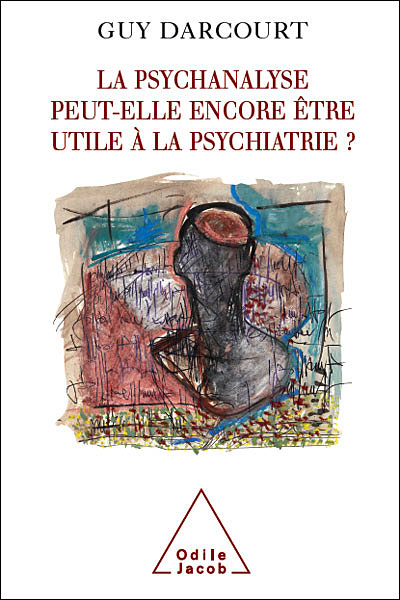
JMT - Guy Darcourt, comment l’idée d’écrire ce livre t’est-elle venue ? Pourquoi l’as-tu écrit, et pour qui ?
GD - Ce projet s’est développé en
deux temps. Je voulais montrer que la théorie psychanalytique n’est
pas seulement utile pour pratiquer la psychanalyse, mais qu’elle permet
aussi de comprendre la clinique psychiatrique. J’avais écrit un
certain nombre de textes dans ce sens, mais ils sont dispersés (dans
des livres d’enseignement, des cours polycopiés, des chapitres
d’ouvrages, des articles de
revues). J’avais envie d’en faire une synthèse pour les présenter
en un tout cohérent et pour développer l’option théorique
qui les sous-tend tous. Je me suis efforcé d’utiliser une terminologie
simple et compréhensible et cela tout en maintenant la rigueur scientifique.
C’était un défi qui m’a plu car je pense que, dans
notre discipline, ce ne sont pas les discours les plus obscurs qui sont les plus
profonds et que les notions les plus subtiles peuvent être présentées
clairement si elles ont été bien élaborées.
Ce livre est donc destiné d’abord aux psychiatres et aux psychologues,
qu’ils soient en formation ou qu’ils s’interrogent sur l’orientation
actuelle de la psychopathologie ou même qu’ils aient abandonné toute
référence à la psychanalyse. Il est, en même temps,
accessible à un large public : malades ou familles à la recherche
d’informations, ou intellectuels curieux de psychologie et intéressés
par l’évolution des idées.
JMT - Il y a dans ton livre une solide critique du DSM. Tu y décris,
en t’appuyant sur plusieurs exemples, comment, lorsqu’il est utilisé en
dehors de son champ de compétence, il peut devenir un obstacle à la
démarche d’investigation clinique, qui permet de comprendre le fonctionnement
psychique et de disposer de concepts pour accueillir les symptômes. Peux-tu
préciser ce point ?
GD - On peut dire des DSM-III, DSM-IV
et de la CIM-10 ce qu’Esope disait de la langue. On peut en faire le meilleur
et le pire des usages. En voici quatre exemples.
- Ces classifications sont destinées à sélectionner des cas non ambigus et pas à dénombrer toutes les formes de pathologie. Elles définissent, en effet, des entités cliniques bien caractérisées et d’une certaine gravité (entraînant « une souffrance cliniquement significative ou une altération du fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines ») et elles renvoient les autres à des catégories de « troubles non spécifiés » qui rassemblent des tableaux cliniques très divers. Le bon côté de la chose est que lorsqu’un auteur rapporte un cas clinique, les lecteurs de toutes cultures comprennent de quoi il s’agit. Mais il y a un mauvais côté dû à un mauvais usage. C’est l’utilisation de ces classifications pour des dénombrements (par exemple pour faire l’étude statistique d’une file active de malades). Soit on respecte les critères et on a une grande quantité de « troubles non spécifiés » ce qui est peu informatif, soit on prend des libertés pour faire entrer les cas peu typiques ou peu graves dans des catégories dont ils ne remplissent pas tous les critères et on manque de rigueur.
- Cette sélection est surtout destinée à la recherche (thérapeutique, biologique ou clinique) et elle peut apporter de la clarté. Mais cela suppose aussi que les cas sélectionnés - parce que caractéristiques et suffisamment sévères - soient représentatifs des cas moins typiques ou plus légers. C’est comme si on expérimentait les traitements anticancéreux uniquement dans les formes métastasées en estimant que ce qui convient pour elles conviendra pour les formes localisées, ce qui serait une erreur. Prenons l’exemple des TOC. Les critères diagnostiques exigés sont tels que peut-être la moitié des patients qui nous consultent pour des troubles obsessionnels n’ont pas leur place dans cette catégorie. Ils ont pourtant besoin de soins, mais est-ce les mêmes que ceux dont relèvent les vrais TOC ?
- Le fait que les critères diagnostiques soient les plus objectifs possible a permis d’établir un vocabulaire psychiatrique international admis et compris par tous, ce qui est bénéfique. Mais c’est réducteur et un usage sain de ces classifications justifie de compléter cette première évaluation par une autre plus profonde. Si un sujet reste cloîtré chez lui parce qu’il a peur de sortir, on diagnostiquera à juste titre une agoraphobie. Mais si on n’approfondit pas l’étude de ses peurs, on ne saura pas s’il redoute un malaise ou une agression, ou s’il a peur de perdre le contrôle de ses actes. On ne saura donc pas s’il est phobique ou obsessionnel. On voit dans la littérature des études de patients « laveurs » ou « vérificateurs » comme si ces groupes étaient homogènes. Si le DSM s’interdit, pour des raisons de consensus, d’explorer le préconscient, pourquoi les praticiens ou les chercheurs s’imposeraient-ils une telle limitation ? Le DSM n’est pas toute la psychiatrie, il en est le « minimum internationalement accepté ». Il est bon de le prendre comme base de départ, mais mauvais de s’y cantonner.
- Un des pires usages est sans doute de considérer que ce qui n’est pas dans le DSM n’existe pas. Prenons le problème des névroses. Les auteurs ont écrit qu’ils n’avaient pas retenu cette entité parce que « actuellement, il n’y a pas de consensus dans le champ de la psychiatrie sur la manière de définir la névrose ». Ils n’ont pas dit qu’elle n’existait pas. C’est un contre sens de le penser et encore plus de considérer que ce manuel le prouve.
JMT - Dans le contexte de la psychiatrie clinique et de l’utilité que peut avoir pour le clinicien la psychanalyse, quels sont selon toi les principaux concepts psychanalytiques qui restent essentiels et, de façon associée, comment définirais tu une approche psychiatrique psychanalytique ?
GD - En reprenant les termes mêmes de ta
question, il faut envisager « l’approche » des
troubles et « les concepts » qui fournissent des modèles
pour les comprendre et donc les traiter.
Ce qui me paraît la pierre angulaire d’une approche d’inspiration
psychanalytique par un praticien non analyste est la distinction entre l’exploration
de l’inconscient et celle du préconscient. Celle de l’inconscient
est impossible en pratique clinique ou risque d’être une interprétation
sauvage ou de rester générale et floue (comme, par exemple, la
référence à la castration qui peut être utilisée
quelque soit la pathologie, ce qui n’apporte donc aucune notion discriminante).
Par contre l’exploration du préconscient est possible. Elle a été oubliée
par de nombreux cliniciens car, rejetant l’interprétation de l’inconscient
(à juste titre avons-nous vu) ils ont rejeté en même temps
celle du préconscient. Paradoxalement, cela a été aggravé par
les psychanalystes eux-mêmes car, étant intéressés
en premier lieu par l’inconscient, ils ont négligé les
textes de Freud concernant le préconscient et celui-ci est tombé dans
l’oubli. Les seuls qui s’y intéressent sont les cognitivistes
mais … ils ne citent jamais Freud !
Parmi les concepts freudiens utiles en clinique, la première place revient
aux mécanismes de défense et surtout à ceux qui sont justement
du domaine du préconscient. Il faut en effet distinguer le refoulement
et les autres mécanismes de défense. Le refoulement est repérable
dans la mesure où le clinicien perçoit bien qu’il doit
y avoir chez son patient des choses profondes et cachées, mais les conditions
de sa pratique ne lui permettent pas de les interpréter. Par contre,
les mécanismes secondaires, qui interviennent pour protéger le
sujet des rejetons de l’inconscient qui arrivent à affleurer à sa
conscience, sont identifiables et interprétables. Ce sont le déplacement,
l’inversion, la négation, la formation réactionnelle, l’isolation,
le clivage, etc. Leur identification permet de comprendre l’économie
psychique et ouvre des possibilités de traitement. Prenons l’exemple
du modèle de la névrose obsessionnelle : selon Freud, il
y a, à la suite d’une fixation au stade sadique-anal, un refoulement
du sadisme qui n’est pas total et laisse revenir à la conscience
certains rejetons contre lesquels vont intervenir les mécanismes d’inversion
et de déplacement. Dans ce modèle, il y a à la fois une
explication causale (la fixation) et la description d’un mécanisme
(la lutte contre l’affleurement du sadisme à la conscience). Même
si on conteste l’explication causale, on peut utiliser le modèle
du fonctionnement car il aide à comprendre le fonctionnement psychique :
si le sujet lutte contre une obsession impulsion, c’est bien parce qu’il
redoute d’avoir envie de faire quelque chose de mauvais s’il relâche
sa vigilance. Quand les cognitivistes disent que le sujet lutte par des compulsions
contre des impulsions archaïques, ils analysent le même processus
psychique et utilisent un modèle analogue, en remplaçant pulsion
par impulsion et défense par compulsion. Or Freud l’avait déjà décrit
en 1895 mais personne ne le dit.
Chaque syndrome psychopathologique est caractérisé par la présence
ou l’absence de tel ou tel type de mécanisme de défense.
Dans la phobie, on repère le déplacement, dans l’hystérie
on perçoit la demande affective culpabilisée cachée derrière
l’effort de séduction. Dans la perversion, la caractéristique
est la carence des mécanismes de défense névrotiques,
alors que, dans les états-limites, il existe un contraste entre la prédominance
d’un mécanisme de clivage et l’absence de la compensation
que pourraient apporter les mécanismes de défense névrotiques.
Une telle compréhension nécessite une certaine subtilité,
mais elle reste pleinement scientifique et est à la portée de
tout praticien, même s’il n’a pas une formation analytique.
JMT - Ta présentation de l’hystérie fait bien apparaître le risque d’incompréhension majeure de la personne et de naturalisation de ses fonctionnements que peut représenter une lecture en surface de ses symptômes. Par exemple, considérer comme de l’égocentrisme ce qui est une demande maladroite d’affection et d’amour. Peux-tu préciser cet aspect ?
GD - Si les DSM et la CIM-10 présentent
les hystériques comme dominateurs, exigeants, égocentriques,
manipulateurs et ont choisi le terme péjoratif d’histrion pour
les désigner, ce n’est pas sans raisons, mais ces raisons sont
mauvaises. La première est qu’on n’utilise pas le modèle
donné par Freud de la « névrose comme négatif
de la perversion ». Alors qu’on l’applique facilement
pour la névrose obsessionnelle et qu’on la considère comme
le négatif du sado-masochisme, on n’a pas identifié une
perversion qui serait le positif de l’hystérie. On parle d’hystérie
perverse mais ce concept est flou et on ne le distingue pas de celui de l’hystérie
névrotique. C’est ce que j’ai essayé de faire dans
ce livre.
La deuxième raison est que, au premier abord, ces sujets évoquent
plus la perversion que la névrose. Mais le spécialiste de la
psychopathologie peut-il se contenter de ce premier abord ? Pourtant les
classifications internationales ne l’incitent pas à aller plus
loin. Elles décrivent des attitudes, mais ne cherchent pas à savoir à quoi
elles sont dues. Elles signalent les comportements de séduction, mais
ne posent pas la question de l’objectif de ce comportement.
Si on approfondit l’observation, on voit bien qu’il s’agit
d’une demande d’amour de type infantile. L’hystérique
qui, voulant séduire par son charme et son exubérance, bascule
souvent dans une position de plainte lorsqu’il constate qu’il échoue.
Se disant incompris et mal aimé, il essaye toujours de séduire,
mais cette fois en inspirant de la compassion. Ce qui est à la base
de ces deux comportements opposés est la même demande affective
intense. C’est bien le moins qu’un clinicien le perçoive !
Ces tentatives de séduction sont qualifiées d’inadaptées
(ou d’inappropriées). Il est vrai que l’hystérique
refuse que cela aboutisse à une relation sexuelle. Là aussi il
convient de rechercher pourquoi. La cause n’en est pas le plaisir qu’a
l’allumeuse perverse de se moquer du partenaire qu’elle a séduit,
mais la fuite devant la perspective d’une relation génitale pour
laquelle l’hystérique n’a pas la maturité. La grande
suggestibilité témoigne que l’hystérique cherche à être
comme l’autre souhaite qu’il soit. Pour attirer son intérêt
ou son amour, il s’efforce de se conformer à ses désirs.
C’est bien une manifestation de demande infantile de sollicitude. Le
sujet est mal à l’aise dans les situations où il n’est
pas au centre de l’attention d’autrui, dit le DSM qui s’arrête à cette
constatation sans poser la question du pourquoi de cette attitude. Or elle
est essentielle : chez l’hystérique, cette attitude n’est
pas due à un besoin de dominer, mais à un manque de confiance
en soi. De même, la CIM-10 signale une tendance à être facilement
blessé, sans envisager l’origine de la blessure : or elle
n’est pas due à une susceptibilité orgueilleuse, mais ici
encore à un manque de confiance en soi. L’hystérie est
un masque brillant qui cache une fragilité affective.
JMT - Ta différentiation des pseudo-psychoses hystériques des autres psychoses et leur rattachement à une forme de contenu onirique lié à un traumatisme est essentielle du point de vue du diagnostic différentiel et de l’approche clinique. Peut-on parler de conversions psychiques et quel en serait l’abord ?
GD - On peut qualifier les pseudo-psychoses
hystériques soit de conversions psychiques et c’est le plus souvent
le cas, soit d’une expansion de l’activité fantasmatique
de l’hystérique. On peut en effet envisager une gradation avec
au minimum une riche vie imaginaire, à un degré de plus la mythomanie,
puis les états-seconds, les états de possession, le fameux syndrome
de personnalité multiple et enfin le « délire ».
Il y a dans tous ces états un déséquilibre entre l’efflorescence
de fantasmes et le contrôle rationnel, mais le degré de déséquilibre
varie. Peu importe d’ailleurs comment on modélise ce fonctionnement,
l’important est d’abord de le connaître et de l’identifier
quand on le rencontre.
Or les classifications internationales l’ignorent. Les seules possibilités
de classement sont de les appeler « trouble psychotique bref (avec
ou sans facteurs de stress marqués) » si elles durent moins
d’un mois et « trouble psychotique non spécifié » si
elles durent plus. Elles perdent ainsi toute individualité.
Les identifier a un double avantage : pratique et théorique. Pratique,
car conduisant à une approche psychothérapique et théorique
permettant de clarifier les débats sur l’efficacité des
psychothérapies dans les psychoses. L’approche psychothérapique
ne sera pas l’interprétation directe de ce délire qui a
les caractères d’un rêve, mais la facilitation d’une
perlaboration sur ce contenu. L’intérêt théorique
est de comprendre les économies psychiques des divers types de délire :
délire systématisé, schizophrénie, pseudo-psychose
hystérique. Ces manifestations délirantes ne relèvent
pas toutes des mêmes mécanismes et on ne peut généraliser à toutes
ce qu’on constate avec l’une ou l’autre forme. Or on voit
des publications qui portent sur la psychothérapie des « psychoses » sans
préciser le type de psychose concerné et qui risquent donc d’utiliser
un modèle spécifique à un type de délire pour une
forme à laquelle il n’est pas adapté.
JMT - Comment expliquerais-tu la difficulté, du moins apparente, des psychiatres, à s’intéresser à la perversion et à s’occuper des pervers ? Peut-on imaginer, si je me réfère à tes critères de définition [p 151], qu’il est particulièrement difficile ou impossible pour un psychiatre de se trouver dans la situation d’être dominé par un autre, ou a-t-il plus ou moins conscience d’être placé dans une situation structurellement indépassable ? Penses-tu, d’ailleurs, qu’elle le soit vraiment ?
GD - Je pense que la première
cause de la méconnaissance de la perversion est la pression du « politiquement
correct ». Les psychiatres - et peut-être les anglo-saxons
plus que les latins - sont obnubilés par le sens péjoratif
et moral qu’a le terme perversion dans le langage courant, et ils n’osent
plus l’utiliser dans son sens psychopathologique. Ils auraient l’impression
de porter un jugement moral sur leurs patients, voire de les injurier, en les
qualifiant de pervers ! Bien d’autres termes de notre langage psychiatrique
comme « dément, hystérique, masochiste, maniaque »,
ont dans la langue vulgaire un sens péjoratif et nous ne nous interdisons
pas de les utiliser. Quelle culpabilité nous interdit de le faire pour
la perversion ?
Il y a aussi une raison dont on a peu conscience : l’image paradigmatique
du couple malade-soignant est celle du bon Samaritain secourant l’affligé et
cela convient bien pour les maladies qui entraînent une souffrance. Or
le malheur du pervers n’est pas de souffrir anormalement, mais de jouir
anormalement et dans ce cas le symbole du bon Samaritain paraît inadapté.
Pourtant il s’agit aussi d’une infirmité ; elle est
certes différente, mais elle est une infirmité tout de même.
Le DSM comme la CIM-10 ne voient de la pathologie que si un trouble est « à l’origine
d’une souffrance cliniquement significative ou d’une altération
du fonctionnement social, professionnel ou dans d’autres domaines importants ».
La notion qu’un plaisir soit anormal est ignorée. Pourtant l’euphorie
du maniaque n’est pas considérée comme un signe de santé,
mais la psychiatrie a perdu l’habitude de porter le même jugement
sur les conduites perverses.
Les facteurs que tu évoques, les difficultés contre-transférentielles
et la conviction d’une inaccessibilité thérapeutique, doivent
jouer un rôle mais ne sauraient suffire. Dans ce cas, en effet, les psychiatres
identifieraient le trouble tout en le considérant impossible à traiter,
comme on le faisait autrefois pour la maladie d’Alzheimer ou pour le
délire paranoïaque. Il y a aussi peut-être une autre raison :
ces sujets consultent peu et les psychiatres les rencontrent surtout à l’occasion
d’expertises ou à la suite d’hospitalisations sans consentement,
ce qui renforce l’impression de délinquance et d’incurabilité.
Cette méconnaissance est une sérieuse défaillance car
de tels troubles ne sont pas rares. Certes les grandes perversions monstrueuses
ne sont pas fréquentes, mais les tendances perverses le sont. Par ailleurs,
il est paradoxal que les psychiatres soient les derniers à les identifier,
alors que les écrivains et les cinéastes les
connaissent bien et nous en présentent des analyses pertinentes.
La réconciliation des praticiens avec ce concept ne peut qu’être
bénéfique pour la pratique psychiatrique. D’abord, en le
définissant de façon précise, on peut distinguer avec
cohérence des fonctionnements psychiques dont les manifestations sont
proches, mais dont les économies sont différentes. Si un sujet
se nuit à lui-même, le processus psychique sous-jacent n’est
pas le même selon qu’il le fait par autopunition (processus névrotique)
ou pour en jouir (processus pervers). Si une femme a une conduite de séduction
sexuelle suivie de rupture quand elle a provoqué le désir, son économie
psychique est différente si elle fuit parce que la réalisation
génitale la panique (processus névrotique) ou si elle cherche à se
moquer sadiquement de celui qu’elle a séduit.
Quant aux possibilités thérapeutiques, elles ne sont pas à envisager
dans la seule perspective du fonctionnement pervers proprement dit. Aucun patient
n’est totalement et exclusivement pervers. Ce fonctionnement est une
dimension de son économie psychique et s’inscrit dans un contexte.
Il peut être une réaction de défense, une décompensation,
une tendance que le sujet cherche à contrôler, etc. Il ne faut
pas oublier que nos modèles psychopathologiques sont toujours réducteurs
et que les personnalités des patients sont toujours complexes et relèvent
de l’intrication de plusieurs modèles. Même si les processus
purement pervers résistent au changement, les divers processus auxquels
ils sont associés résistent moins et leur évolution peut
modifier l’équilibre de la personnalité.
JMT - Tu présentes, à propos des états limites
et du narcissisme une discussion approfondie des classifications et des approches
conceptuelles. Tu reprends les principaux modèles et décris comment
deux voies de traumatisme précoce, par carence du monde extérieur
ou par incapacité d’un moi immature à faire face à un
assaut pulsionnel
important, peuvent empêcher le moi de conquérir sa cohérence,
conduisant la personne à réagir de façon instable et disproportionnée
aux variations de l’environnement personnel. Tu termines ce chapitre
en soulignant que la psychanalyse complète l’approche descriptive
en lui donnant un sens, ce qui ne peut qu’aider le praticien à porter
le diagnostic et à traiter son patient. Ne penses-tu pas qu’il
y aurait là matière à un véritable chantier pour
les cliniciens : préciser comment ils font pour avancer avec ces
patients si difficiles ?
GD - Dans les modèles psychanalytiques
des maladies psychiques il y a toujours deux volets : une explication « causale » et
un modèle structural. Ces deux volets ne méritent pas la même
discussion. On peut très bien contester l’explication causale
tout en admettent le modèle structural sans que cela retentisse sur
la pratique clinique. Les deux théories du traumatisme que tu rappelles,
celle de la carence du monde extérieur et celle d’un assaut pulsionnel
débordant les capacités de maîtrise du sujet ont chacune
leurs défenseurs. La discussion reste ouverte sur ce point.
Par contre, il y a accord sur le modèle structural et c’est cela
qui importe pour éclairer la clinique. Je me dois de préciser
que j’ai pris plus de liberté pour ce modèle structural
que pour les modèles névrotiques et pervers. C’est un domaine
que Freud n’a pas exploré, à propos duquel les psychanalystes
ont encore des avis divers et qui est en pleine évolution. J’ai
donné une vue assez générale des débats, mais j’ai
surtout avancé mes choix personnels. Pour le narcissisme, la notion
d’une estime de soi qui est fragile et oscille entre deux extrêmes :
l’inflation et l’effondrement me paraît fournir le modèle
le plus pertinent pour comprendre cette pathologie. Pour les états-limites,
c’est la notion de clivage (clivage entre les représentations
et les affects et entre les divers moments de la vie psychique) qui me paraît
donner la clé de la compréhension. Le terme chantier me convient.
Je suis prêt à argumenter ma position mais je ne prétends
pas détenir la vérité. Ce chantier doit être autant
théorique que pratique puisque les méthodes thérapeutiques
dépendent des modèles sur lesquels on se repère.
JMT - Tu dis que les non analystes ont rejeté la psychanalyse, mais les psychanalystes n’ont-ils pas une responsabilité dans ce divorce ? Et d’autre part, comment expliquer que des modèles aussi « simples » que certains de ceux qui sont présentés comme une clé universelle par le cognitivo-comportementalisme ne soient pas davantage discutés ?
GD - Je ne suis pas aussi sévère que
tu sembles l’être (du moins à travers la formulation de
ta question) envers le cognitivo-comportementaliste. Ses concepts ne sont pas
toujours simplistes et il aide un grand nombre de patients. Je lui reproche
seulement deux choses : de ne pas reconnaître qu’il utilise
un bon nombre de concepts déjà énoncés par Freud
et de rejeter la psychanalyse alors qu’il est une technique qui a sa
place à côté d’elle, mais qu’il ne la remplace
pas et qui a des indications différentes.
Quant à la responsabilité des psychanalystes dans le divorce
entre la psychiatrie et la psychanalyse, je la reconnais mais je n’ai
par eu le cœur d’y insister ! Ce tort est venu, à mon
sens de leur désintérêt pour la clinique psychiatrique … à la
différence de Freud d’ailleurs. Les travaux des psychanalystes
portent en général sur l’inconscient et la technique de
la cure. C’est à juste titre, mais il est dommage qu’ils
ne portent pas aussi sur le préconscient et sur les modèles que
la psychanalyse peut découvrir pour enrichir la psychopathologie, et
il est encore plus dommage de voir certains collègues rejeter avec force
de telles démarches. Ce n’est d’ailleurs pas nouveau. Je
cite Anna Freud qui déjà en 1946 s’insurgeait contre les
psychanalystes qui voulaient réserver le nom de psychanalyse à « la
vie psychique inconsciente » et qui accusaient d’ « apostasie » ceux
qui portaient intérêt au préconscient. Pourtant la clinique
psychiatrique a encore besoin de la théorie freudienne du préconscient.
Le narcissisme et les états-limites en sont un des plus récents
exemples, les travaux psychanalytiques ont apporté des éléments
de compréhension que l’approche strictement psychiatrique n’aurait
pu découvrir. J’espère ne pas être traité à mon
tour d’apostat, mais si cela se produit je l’assumerai volontiers
car la psychiatrie ne peut que profiter de cette apostasie !
****
Sur ce sujet, nous avons souhaité recueillir l’avis de personnes engagées dans le champ psychiatrique, ayant des profils assez différents, et qui nous ont semblé avoir témoigné de leur intérêt pour ce sujet.
Nous leur avons demandé d’essayer de répondre, selon
leur propre point de vue et en l’argumentant comme ils le souhaitaient, à la
question générale « La psychanalyse peut-elle encore être
utile à la psychiatrie ? » en envisageant trois axes
: celui de la psychopathologie (comme référence intervenant
dans la compréhension et l’approche générale),
celui de la thérapeutique (psychothérapie et/ou approche médicamenteuse)
et celui de la recherche, avec la question de la relation avec les neurosciences
Philippe CIALDELLA
Le libellé de votre question laisse entendre que la cause serait presque
perdue, mais la réalité de la situation est, bien entendu, complexe,
et ma réponse sera parcellaire. La psychiatrie englobe de multiples
apports, dont la psychanalyse, laquelle ne peut prétendre à l’exclusivité.
N’étant pas psychanalyste, et ayant une pratique plutôt
biologique et de thérapie de soutien, auprès de patients où dominent
les déprimés et surtout les bipolaires, j’utilise peu les
notions psychanalytiques, qui me semblent mal adaptées à ces
patients. Par exemple, je doute du rôle de la « défense
maniaque », car la possibilité du virage maniaque dépend
de multiples facteurs, certains étant biologiques (par exemple une prescription
d’antidépresseur) et le rôle possible d’une intentionnalité inconsciente,
qu’implique le concept de défense, me paraît insuffisant
et parfois plaqué.
Plus généralement, j’ai toujours été gêné du
décalage entre le pouvoir explicatif de la psychanalyse et le peu d’efficacité de
ces explications, notamment sur les psychoses.
Toutefois, ayant été imprégné du discours analytique
durant ma formation, il ne doit pas être totalement refoulé, et
quand je crois faire de la thérapie de soutien, je m’appuie, même
sans y faire appel de façon explicite, sur tout un ensemble de notions
issues de la psychanalyse, notamment le transfert et le contre-transfert. Les
modèles psychanalytiques sont ceux qui rendent le mieux compte de l’élément
historique personnel et de la singularité de l’expérience
humaine et, de fait, ils permettent d’écouter tous les types de
demande et de problématique des patients reçus en libéral.
La description des névroses classiques par Freud me paraît toujours
utile, même si, dans mon approche de troubles où j’attribue
un rôle central à l’apprentissage (par exemple les phobies),
je fais appel à des éléments provenant des théories
cognitives.
Quant à la pratique de mes collègues proches, une enquête
récente (2006) de l’Union Régionale des Médecins
Libéraux Rhône-Alpes montrait que la proportion de temps consacrée
aux psychothérapies d’inspiration analytique (PIP) était
de 32% chez les psychiatres libéraux, tandis que le temps consacré aux
thérapies cognitivo-comportementales n’était que de 5%.
Il y a donc encore une forte prééminence du modèle psychanalytique,
qui s’estompera à l’avenir, du fait de la démographie
et de la moindre attirance des jeunes psychiatres pour la psychanalyse, mais
le changement mettra quelques années à se matérialiser.
Cet aspect chronophage des PIP explique en partie les longs délais de
rendez-vous chez le psychiatre libéral, un problème d’actualité.
De fait, si l’on s’en tenait strictement au critère temps,
on dirait que la psychanalyse nuit à l’exercice de la psychiatrie,
en empêchant une frange importante des patients d’accéder
au soin psychiatrique, laquelle s’en retourne finalement vers son médecin
généraliste ou va consulter des thérapeutes non médecins,
hors du circuit psychiatrique. Mais le critère temps n’est pas
le seul, et l’évaluation des résultats est ici fondamentale,
ce qui est une toute autre question.
Philippe Cialdella est psychiatre libéral et dans le secteur médico-social à Lyon.
180 route de Vienne, 69008 LYON - p.cialdella@free.fr
Pierre-Henri CASTEL
Je ferais volontiers la conjecture suivante : l’effacement progressif
de la psychanalyse dans le champ psychiatrique français au cours de
ces vingt dernières années a, à peu près, atteint
son ampleur maximum. Quelques signes suggèrent que le balancier repart
doucement dans l’autre sens, du même pas d’ailleurs qu’on
sent dans le public un appel à des prises en charge individualisées,
en tout cas pas uniquement « objectivistes », que divers
scandales sanitaires font de nouveau sentir l’exigence d’une psychiatrie
sociale (lieu naturel d’interactions psychodynamiques fortes) et que
les alternatives thérapeutiques opposées à la psychanalyse,
comportementales, pharmacologiques, marquent à leur tour le pas - qui
est tout bêtement celui de ce qui « reste à soigner et
sur quoi personne n’a prise ».
En même temps, je pense qu’on peut avec quelques raisons parier
que le balancier n’ira pas rejoindre la position qu’il occupait
dans les années 1980. La coupure restera, je suppose, définitive
entre le prestige intellectuel de la psychanalyse (intéressant les psychologues)
et le genre de scientificité neurobiologique qui désormais fera
norme (et réglera la carrière des psychiatres). De même,
peu de gens iront soutenir qu’il existe une sorte de contre-psychiatrie
psychanalytique, avec sa clinique, sa nosographie, ses voies thérapeutiques
radicalement autonomes, son « sujet » enfin, ou que des distinctions
comme névrose/psychose pourraient retrouver le crédit que leur
conférait l’osmose entre psychiatrie et psychanalyse à l’époque
de Ey.
Mais ce dégraissage salutaire n’émousse sûrement
pas la qualité spéciale que la psychanalyse a apportée
et continue d’apporter à la réflexion sur les maladies
mentales. Pour nombre de jeunes internes, la psychanalyse offre toujours le
moyen de nommer et de penser ce que nul ne veut savoir en médecine mentale.
Que les actes imprévisibles et catastrophiques, la perversion excitée
chez les soignants par des patients sans défense, les conséquences
paradoxales des bonnes intentions, que tout cela n’est pas pure contingence
hors-sujet, mais un aspect essentiel de nos relations avec la folie. A cela
s’ajoute la découverte que la condition impérative pour
créer les liens fidèles et endurant que savent si bien reconnaître
les patients, passe justement par la reconnaissance qu’en un sens dérangeant,
ils disent avec leur maladie quelque chose de vrai sur eux-mêmes et sur
la condition humaine, et que nous avons en commun les questions les plus graves.
La psychanalyse reste un moyen de faire en sorte que ces considérations
ne soient pas la philosophie humaniste que n’importe qui peut développer à côté de
ses activités quotidiennes, mais un facteur de modification personnelle
au contact clinique des patients. Comme en droit, il lui faut conquérir
un statut d’opinion dissidente (même minoritaire).
Le point décisif est alors celui-là : la psychanalyse pourra-t-elle
offrir un fil conducteur qui montre l’unité épistémologique
de toutes les minuscules failles de la culture objectiviste en médecine
mentale ? Pourra-t-elle en tant que discipline spécifique recueillir
ce qui est rejeté par principe en science comme « subjectif »,
non-quantifiable, et qui relève en pratique du pari sur la signification
et la vérité de symptômes psychiques traités comme
de simples dysfonctionnements ? Car seule cette qualité épistémologique
peut la préserver de dégénérer en supplément
d’âme à l’âge des neurones-rois.
Pierre-Henri Castel est psychanalyste, chargé de recherches au CNRS
et au CESAMES (CNRS-INSERM-Université Paris 5)
pierrehenri.castel@free.fr
Julien Daniel GUELFI
Un de mes maîtres d’internat me prédisait jadis la fin imminente
de la psychanalyse et de la philosophie. Ces deux disciplines représentaient
pour lui des exemples flagrants de fausses sciences pérennisant l’obscurantisme.
Il manifestait une foi absolue dans l’avancement inéluctable des
sciences qui aurait bientôt raison de tous les charlatanismes …
Quarante années après ces prévisions, et malgré la
diminution de l’influence de la psychanalyse chez les jeunes psychiatres
d’aujourd’hui, je pense que ce maître à la personnalité par
ailleurs attachante et au talent littéraire incontestable, s’est
lourdement trompé. Les sciences progressent plus par l’intégration
des modèles théoriques passés que par leur rejet systématique.
Oui, ami Guy Darcourt, je pense comme toi que la psychanalyse peut encore être
utile à notre discipline comme - de façon beaucoup plus générale
- à la pensée de l’homme.
Comme toi je pense que l’écoute « de la vie fantasmatique
profonde fait entrevoir des structures et des processus cachés à l’observation
clinique..., permet d’aller au-delà des comportements et d’imaginer
les mécanismes psychiques qui les sous-tendent ».
Sur le plan psychopathologique, la psychiatrie ne peut que s’enrichir
d’une exploration méthodique du préconscient, de la notion
de plaisir pathologique, de l’approche psychodynamique des déviations
sexuelles, de celle de perte d’objet dans le deuil comme dans l’ensemble
de la problématique dépressive, ou encore de l’organisation Borderline de
la personnalité.
Cet avatar du développement psychologique garde aujourd’hui encore
une grande part de son mystère ; il serait cependant difficile
de nier le caractère heuristique des travaux théoriques
de Otto Kernberg, Hans Kohut, Jean Bergeret, Bela Grunberger, Daniel Widlöcher
ou John Gunderson en la matière.
Sur le plan thérapeutique, la psychanalyse est en perte de vitesse dans
le hit-parade des psychothérapies. Mais, dans ce domaine aussi, perte
de vitesse ne signifie pas disparition. Les progrès réalisés
en méthodologie de l’évaluation du résultat en psychothérapie
joints à la participation active de certains psychanalystes acceptant
le principe même d’une évaluation comme l’américain
Glenn Gabbard permettront certainement de progresser dans les prochaines années à propos
du choix des indications en matière de psychothérapie.
Enfin les rapports de la psychanalyse avec les neurosciences représentent
une voie de réflexion en plein essor. En témoigne la publication
de plusieurs livres sur ce sujet. Un des plus stimulants est sans doute celui
de Bruno Falissard sur « Psychanalyse et cerveau ». Un
grand merci à Guy Darcourt pour cet apport d’un psychanalyste à notre
discipline.
Julien-Daniel Guelfi est professeur de psychiatrie, Clinique des Maladies mentales
et de l’encéphale, Centre Hospitalier Saint-Anne. 75014 PARIS
-JD.GUELFI@ch-sainte-anne.fr
Bernard GOLSE
Le fait même que la question puisse se poser à de quoi irriter,
tant il est clair que la psychanalyse n’a pas fini de rendre des services à la
pédopsychiatrie.
La psychanalyse a certainement eu, dans le passé, une influence plus
grande qu’aujourd’hui sur la pédopsychiatrie, mais la cause
est loin d’être perdue.
Il est possible que la deuxième partie du vingtième siècle
qui aura été le temps de la découverte du cerveau et du
code génétique ait quelque peu, mais seulement transitoirement, éclipsé la
première partie de ce siècle qui avait vu la naissance de la
psychanalyse.
- La psychanalyse et le modèle psychopathologique
Le dialogue entre pédopsychiatres et psychanalystes est certes possible,
mais il s’inscrit tout de même sur l’arrière-plan
d’une confrontation entre des modèles épistémologiques
distincts, peut-être pas totalement incompatibles, mais qui s’opposent
tout de même point par point.
Le modèle pédopsychiatrique apparaît, aujourd’hui,
comme à la recherche d’une position intermédiaire entre
le modèle pédiatrique et le modèle psychanalytique.
• Le modèle pédiatrique est un modèle principalement
linéaire, à visée d’efficacité rapide, et
de nature déductive, en référence à une temporalité linéaire.
• Le modèle psychopathologique psychanalytique est un modèle
non linéaire mais fondamentalement polyfactoriel, en référence à la notion
classique de « série complémentaire » (S.
Freud), nécessairement lent (en référence à la « capacité négative » décrite
par W.R. Bion), et de nature inférentielle (en référence à une
temporalité circulaire apte à prendre en compte les effets d’après-coup.
• Le modèle (pédo)psychiatrique apparaît aujourd’hui
comme à la recherche d’un compromis entre les deux modèles
précédents, en tentant d’introduire une temporalité circulaire
au sein du modèle psychiatrique académique qui demeure de type
médical. Nous avons ici à tenir compte, désormais, des
effets désastreux du DSM III et surtout du DSM IV, peu à peu
utilisé dans les facultés comme un Manuel de Psychopathologie
en soi … alors même qu’il donne de la nosologie la conception
la plus plate et la plus descriptive qu’on puisse imaginer.
- La thérapeutique
La thérapeutique ne peut faire l’économie de l’histoire
du sujet et de ses troubles.
C’est tout l’honneur de la pédopsychiatrie que de chercher,
sans relâche, à croiser l’axe synchronique et l’axe
diachronique de l’approche de la psychopathologie. Si l’on néglige
l’axe synchronique, on se situe dans une psychopathologie éthérée
et désincarnée, mais si l’on néglige l’axe
diachronique, on ne peut céder qu’aux mirages de l’évaluation
et de l’idéalisation de l’instant « t » !
Il n’y a qu’à voir ce que donne la prise en charge seulement
médicamenteuse et anhistorique des troubles obsessionnels avec provocation
ou de l’hyperactivité par exemple, pour bien se persuader de tout
ce que la compréhension psychanalytique des troubles peut encore apporter à l’efficacité des
traitements.
On sait aujourd’hui qu’un traitement médicamenteux et psychothérapique
de l’hyperactivité est plus efficace, et plus durablement efficace,
qu’une prise en charge médicamenteuse ou psychothérapique
isolée.
- La recherche
Il y a bien sûr des divergences de fond quant au concept même de
recherche en psychiatrie et en psychanalyse.
Il n’en demeure pas moins qu’on voit se dessiner aujourd’hui
des points de convergence fort intéressants entre psychanalyse et cognition,
même si l’échelle des points de vue n’y est en rien
la même (les mécanismes de l’oubli étudié par
les cognitivistes ne se situent pas, par exemple, sur le même plan que
les processus de refoulement étudiés par les psychanalystes !).
A la condition expresse d’un respect réciproque sans faille et
d’une curiosité mutuelle suffisante, la psychanalyse peut proposer
des thématiques d’étude aux neurosciences (le rêve,
la mémoire, le désir …) et les neurosciences peuvent venir étayer
ou invalider certaines des intuitions cliniques de la psychanalyse.
C’est tout l’axe de travail de la « Société de
Neuro-Psychanalyse » fondée à Londres il y a quelques
années, société qui s’avère très vivante
et dont nous tentons actuellement de mettre en place la branche francophone
avec D. Widlöcher, A. Braconnier et L. Ouss notamment.
A nous de ne pas oublier cependant que si l’objet des neurosciences est
le fonctionnement du cerveau à ses différents niveaux, l’objet
de la psychanalyse est l’étude du matériau co-créé en
permanence par les deux psychismes de l’analyste et du patient.
Bernard Golse est professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent,
Hôpital Necker-Enfants Malades. 75015 Paris
bernard.golse@nck.aphp.fr
Nicolas GEORGIEFF
Tout dépend de ce que deviendront la psychiatrie comme la psychanalyse...
Du point de vue d’abord de la lecture clinique, la psychanalyse offre
une approche descriptive originale et incomparablement fine des états
et des processus mentaux, ainsi qu’une lecture fonctionnelle. Elle rend
possible une sémiologie de niveaux d’organisation fonctionnels
complexes (représentations de soi, mécanismes de régulation émotionnelle,
processus intersubjectifs) peu accessibles à d’autres approches.
Cette clinique guidée par la psychanalyse est nécessaire pour
identifier des processus (deuil, identification, projection, anomalies de la
conscience de soi) et des organisations pathologiques (troubles narcissiques, états
limites) qui s’offrent ensuite à d’autres lectures, biologique,
cognitive, épidémiologique.
Du point de vue de la pratique de compréhension d’autrui, tant
que la psychiatrie impliquera une pratique clinique interpersonnelle, la psychanalyse
lui sera utile en tant qu’elle propose une méthode et une théorie
sans équivalent pour appréhender le psychisme d’autrui
ainsi que son psychisme propre, et leur interaction. Elle constitue un modèle
de référence pour diverses pratiques psychothérapiques
applicables, à côté d’autres, dans divers cadres
et à diverses pathologies, ainsi qu’aux organisations groupales
en général. Sa spécificité est de prendre en compte
la complexité de l’intentionnalité multiple des conduites,
donc leurs déterminants internes au sujet, et l’interaction ou
co-action psychique avec le thérapeute. Le cadre de la « cure
type » devrait rester un outil de formation des professionnels,
donc des psychiatres si ceux-ci restent des psychothérapeutes. Mais
cette perspective est dépendante de la manière dont la psychanalyse,
de son côté, saura étendre ses intérêts, au-delà la
cure type, au champ plus large des psychothérapies.
En ce qui concerne la compréhension de la pathologie, la psychanalyse
sera utile à la psychiatrie tant que celle-ci se référera à une
psychopathologie générale, et il est essentiel aujourd’hui
de réfléchir à la manière dont la psychanalyse
s’articule, dans une psychopathologie plurielle, aux autres approches
: neurobiologique et cognitive, anthropologique, sociologique, psychologique … La
psychiatrie a la particularité de convoquer non pas une mais plusieurs
sciences fondamentales, de la biologie moléculaire aux sciences humaines,
qui offrent chacune une perspective sur un niveau d’organisation ou de
complexité de son objet. C’est sa richesse. Mais dans ce cadre,
la portée de la psychopathologie explicative extrapolée par Freud à partir
de sa pratique doit être remise en question. La psychiatrie a d’ailleurs
abandonné les explications causales exclusives quelles qu’elles
soient. La psychanalyse propose un niveau d’explication dont l’intérêt
est d’éclairer, avec d’autres approches, l’importance
des déterminants intrapsychiques et environnementaux interhumains de
la pathologie.
La psychiatrie s’appuie donc sur des systèmes de connaissance
hétérogènes, et aujourd’hui cette diversité pose
problème. Les représentations du psychisme issues de la psychanalyse
reposent sur un mode particulier d’échange interpersonnel, et
elles ne peuvent être mises sur le même plan, épistémologiquement,
que les représentations issues de l’étude objective et
de l’expérimentation. Pourtant l’un et l’autre point
de vue sont nécessaires à la psychiatrie, et il faut comprendre
leur cohérence. C’est en fait un cas particulier d’un problème
crucial : le clivage qui se crée en psychiatrie entre les sciences
cliniques fondées sur l’intersubjectivité, et les sciences
expérimentales, donc entre chercheurs et cliniciens, comme en témoignent
des polémiques récentes. Cette crise a pour origine un clivage
idéologique entre les orientations théoriques qui doit être
dépassé.
Ce point rejoint donc directement la question des relations entre psychanalyse
et neurosciences, notamment la psychologie scientifique contemporaine (les
sciences cognitives). Leur objet réel - le psychique ou la vie mentale
- est nécessairement commun ; l’échange est donc possible
et nécessaire pour le progrès de la connaissance, et les théories
compatibles. Mais les points de vue sont si différents qu’il n’est
pas possible de projeter un modèle sur l’autre, de faire se correspondre
terme à terme les concepts, comme on l’a trop souvent fait. Un
travail de traduction entre ces langues étrangères désignant
les mêmes réalités est nécessaire pour définir
les points de convergences : par exemple les systèmes de représentation
de soi et d’autrui, les mécanismes d’empathie ou de co-psychéité,
objets communs de la psychanalyse et des neurosciences « sociales ». Ceci
conduit d’ailleurs à envisager l’étude par les neurosciences
de la psychanalyse elle-même, qu’il s’agisse du processus
inter ou co-subjectif sur lequel repose sa pratique, ou des mécanismes
neurocognitifs des processus de changement qu’elle induit.
Pour conclure, les oppositions passées et les différences fondamentales
entre neurosciences et psychanalyse ne doivent pas faire oublier qu’elles
sont les deux principales tentatives historiques menées pour développer
une science de l’esprit, qu’elles inspirent les principales théories
du psychique, et que leur alliance ouvre un champ de recherche d’importance
majeure pour l’avenir de la psychiatrie, théorique et clinique.
Nicolas Georgieff est professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université Claude-Bernard
Lyon 1, Hôpital du Vinatier 69677. BRON -nicolas.georgieff@univ-lyon1.fr

Du nosographique au psychopathologique
Daniel Widlöcher
Il est absurde de se complaire dans des polémiques contre les classifications
psychiatriques internationales, et leur modèle américain, qui
se sont développés au cours des dernières décennies.
La question est de savoir délimiter l’opportunité de leur élaboration
et le champ de leurs applications. La classification descriptive (nosographie)
des troubles mentaux est une tâche que les psychiatres ont toujours tenue
pour une nécessité : nécessité pratique pour
rendre scientifiquement accessibles à tous les résultats d’une
enquête épidémiologique ou ceux d’un essai thérapeutique ;
c’est aussi une nécessité théorique dans la mesure
où, de la classification des troubles mentaux, résulte une vue
d’ensemble (nosologie) sur la nature de ces troubles. Indépendamment
de ces principes nosologiques sur lesquels nous reviendrons, la nécessité de
nature pratique demeure indiscutable. Nous avons besoin d’un langage
commun, aussi réducteur et simplificateur qu’il paraisse.
Mais nous ne devons pas faire un mauvais usage de ce système. Classer empiriquement les données est une méthode, en dégager une compréhension d’ensemble de la pathologie mentale en est une autre. Passer d’une nosographie à une nosologie n’est pas une affaire simple. Les troubles mentaux que nous classons d’un point de vue résolument descriptif ne relèvent pas nécessairement d’un domaine homogène. Les causes des troubles sont variées, multiples souvent, relevant de facteurs psychologiques, sociaux et biologiques. Les mécanismes qui les engendrent se situent à plusieurs niveaux, depuis les bases neuronales jusqu’à la complexité des effets de l’environnement psychosocial. Les variations symptomatiques du comportement que nous tenons pour anormales doivent être comprises en comparaison avec les variantes de la normale. Notre intelligence de la pathologie mentale doit prendre en compte ces divers plans d’analyse. Ce sont eux qui vont guider nos stratégies thérapeutiques et orienter nos programmes de recherche. Si l’évaluation requiert des critères précis et simples, la recherche nécessite des hypothèses qui se situent sur un plan ou sur un autre et des méthodes de vérification appropriées.
Or, l’excellence descriptive des classifications nosographiques modernes, en particulier celle du DSM IV, ont paru suffire à la pratique psychiatrique. Et pourtant la consigne était claire : décrivez le cas de votre malade avec toutes les nuances que l’ensemble de la pathologie vous autorise à faire et ensuite pliez vous à la contrainte d’une classification purement descriptive. Si la classification DSM IV s’étaye sur des critères sémiologiques d’une précision remarquable, elle risque toujours d’appauvrir considérablement la pratique clinique et de stériliser la recherche.
C’est dans un souci, non de corriger, mais de compléter de DSM IV qu’a été conçu le « Manuel Diagnostique Psychodynamique » (« Psychodynamic Diagnostic Manual » - PDM). Il était difficile de construire un manuel qui traite de la totalité des dimensions étiologiques, pathogéniques et multifactorielles. Il fallait choisir. Et ce sont des cliniciens, praticiens et chercheurs du domaine de la psychanalyse, certes ouverts aux autres domaines, qui ont collaboré à la rédaction de ce manuel. Le terme « psychodynamique » doit être entendu en référence à la pratique et à la théorie psychanalytiques. Il s’est développé autour du principe qu’une classification cliniquement utile doit commencer par une compréhension du fonctionnement mental sain. La santé mentale implique davantage que la simple absence de symptômes ; elle prend en compte le fonctionnement général de l’esprit d’une personne, incluant ses relations, sa régulation affective, ses capacités d’adaptation et ses aptitudes à l’observation de soi-même. La compréhension du pathologique présuppose que nous puissions le situer en comparaison à l’éventail complet des capacités humaines cognitives, émotionnelles et comportementales. La tradition psychanalytique a une longue histoire d’examen du fonctionnement général de l’esprit dans une perspective de recherche et de compréhension, avec une approche à la fois dimensionnelle et contextuelle des processus mentaux. Toutefois, la précision diagnostique et l’utilité des approches psychanalytiques ont été doublement compromises. D’une part, dans le souci de saisir l’éventail complet et la subtilité de l’expérience humaine, les descriptions des processus mentaux ont été exprimées selon des théories concurrentes et des métaphores qui ont nui à tout effort de consensus. Ensuite, il y a eu beaucoup de difficultés à établir une distinction entre les hypothèses spéculatives et le repérage des faits.
Comment, dès lors, répondre à la dimension nécessairement
réductrice de la classification DSM IV par des ajouts critiques complémentaires
qui permettraient à la pratique psychodynamique de trouver sa place
dans un champ conceptuel intermédiaire entre les contraintes descriptives élémentaires
du DSM IV et les principes conceptuels et techniques qui guident la pratique
psychanalytique ? C’est la tâche à laquelle se sont
livrés un ensemble d’instituts psychanalytiques. L’Association
américaine de psychanalyse, l’Association internationale de psychanalyse,
la division de psychanalyse de l’Association psychologique américaine,
l’Académie américaine de psychanalyse et de psychiatrie
dynamique et le Comité pour la psychanalyse en « clinical
social work » ont conjointement lancé un programme, à l’organisation
duquel j’ai personnellement participé au titre de Président
de l’Association psychanalytique internationale. Nous avons donc créé des
groupes de rédacteurs en fixant des thèmes d’exposition.
Ceux-ci ont, pour la plupart, été traités par des collègues
américains et anglais, à l’exception de celui dont j’ai
personnellement proposé la rédaction par un groupe de collaborateurs
français sur le thème des entretiens préliminaires et
de l’accessibilité au traitement psychanalytique.
Deux idées forces me semblent inspirer l’ensemble de l’ouvrage.
La première est le continuum entre le fonctionnement psychique normal
et le pathologique. En ce sens, le livre est un authentique manuel de psychopathologie.
La seconde idée force est de se plier en un sens à la rationalité du
DSM IV, non pour le partager mais, au contraire, pour y insérer l’autre
rationalité qui inspire le PDM. Celle-ci ne se fonde pas sur la seule
expérience clinique, elle prend en compte toutes les formes de recherche
sur lesquelles s’appuie le développement actuel des pratiques
psychanalytiques.
Le plan général de l’ouvrage illustre bien ces principes,
cette rationalité propre au PDM. Trois grandes parties composent l’ouvrage.
La première traite de la classification des troubles de la santé mentale
des adultes et envisage successivement les troubles de la personnalité (comme
modèle de continuum) puis un ensemble de profils du fonctionnement mental,
et enfin seulement après elle reprend la classification des symptômes
telle qu’elle figure dans le DSM IV en incluant pour chacun d’eux
les apports spécifiques de la psychopathologie dynamique. La même
force de présentation est reprise dans la seconde partie qui traite
du sujet en développement, de la première enfance à l’adolescence.
Elle envisage tout d’abord les profils du fonctionnement mental tout
au long du développement en articulant de manière très
originale le développement lui-même et ses altérations.
Ensuite seulement est reprise la classification des troubles de la personnalité,
propres à l’enfance et à l’adolescence, et enfin
la révision des classes de symptômes. Une troisième partie
traite des fondements conceptuels et des données de la recherche appliqués à cette
classification « psychodynamique » et comporte des études
historiques, des bilans critiques portant sur les relations avec les sciences
voisines et les méthodologies de recherche.
L’ouvrage dans son ensemble constitue un remarquable manuel de psychopathologie « dynamique ».
Certes, la teneur de la plupart des contributions est fortement marquée
par l’origine nord-américaine des auteurs. Si on veut bien se
garder de tout préjugé chauvin, on y trouvera des éclairages
intéressants et des ouvertures à des perspectives nouvelles pour
nous.
Ce manuel, fort peu onéreux du fait de sa publication dans une structure
de non profit, intéresse certes les psychanalystes et tous ceux qui
se réclament de la psychopathologie dynamique, mais devrait surtout
intéresser l’ensemble des psychiatres. Ils y trouveront la contribution
que les cliniciens et les chercheurs qui travaillent dans le champ de la psychopathologie
dynamique peuvent apporter à une approche strictement descriptive et
classificatoire de la psychiatrie, aussi bien pour guider leur pratique clinique
que comme cadre conceptuel dans les domaines de la recherche.
Daniel Widlöcher daniel.widlocher@psl.ap-hop-paris.fr
La psychopathologie de l’enfant dans le Psychodynamic Diagnostic
Manual : quelques avancées et quelques impasses.
François Sauvagnat
Le PDM a constitué incontestablement un progrès par rapport au
DSM dans le paysage états-unien de la psychiatrie. Par rapport aux DSM,
qui ne retenaient en fin de compte que des critères comportementaux,
praticiens et chercheurs inspirés par la psychanalyse et s’occupant
particulièrement de psychopathologie infanto-juvénile pouvaient
avoir le souci de promouvoir au moins cinq types d’améliorations :
u trouver des solutions satisfaisantes par rapport à l’envahissante
question de la comorbidité, problème que les versions successives
du DSM n’ont pu améliorer ;
- se rapprocher du vécu intérieur des patients, intégrer
la question de l’inconscient et des pulsions dans le diagnostic ;
u maintenir une approche réaliste en ce qui concerne la question de
la causalité, et en particulier différencier les hypothèses
de recherche en fonction de l’existence ou non de preuves clairement
administrées ;
- décrire les particularités du vécu infantile et clarifier
les différences entre pathologies infantiles, adolescentes, et propres
aux adultes ;
- améliorer les pratiques de santé mentale dans un pays défavorablement
classé par la recherche internationale (36e rang mondial pour l’efficacité des
pratiques médicales OMS 2000 ; dernier rang des pays industrialisés
en ce qui concerne la qualité de la vie des enfants UNICEF 2006).
Plusieurs stratégies étaient possibles : soit se focaliser
uniquement sur certains aspects descriptifs (cela a été le cas
de la CFTMEA, avec seulement deux axes principaux, diagnostic et facteurs associés,
plus l’axe I « bébé », mais la CFTMEA
n’est pas citée), ou au contraire envisager de façon globale
le processus de diagnostic, en intégrant un plus grand nombre de dimensions,
comme le propose l’Operationalisierte Psychodynamisches System en
Allemagne (avec cinq axes distincts : axe1 : expérience de la maladie
et préréquisits du traitement, axe 2 : aspects relationnels,
axe 3 : conflits, axe 4 : structure, et axe 5 : syndrome
et diagnostic selon l’ICD 10) ; l’OPD est d’ailleurs
présenté dans un chapitre distinct de l’ouvrage. La stratégie
choisie par les promoteurs du PDM a consisté à conserver
l’axe I du DSM (sans modification), à enrichir considérablement
l’axe des troubles de la personnalité (qui passe de 11 à 24
items !), et surtout à ajouter un axe de fonctionnement mental
(partiellement inspiré par l’axe 4 de l’OPD).
En ce qui concerne la psychopathologie de l’enfant, trois ajouts sont
notables dans le PDM : un chapitre spécifique aux troubles de l’enfant
et de l’adolescent ; les trois axes ont été adaptés
en fonction des spécificités propres aux enfants et aux adolescents
; un sous-chapitre concernant les particularités des nourrissons et
jeunes enfants a été ajouté.
En ce qui concerne l’axe MCA (fonctionnement mental enfants et adolescents),
les neuf dimensions relevées chez l’adulte (capacité de
régulation, capacité de relation et d’intimité,
qualité d’expérience interne, expériences affectives,
capacités défensives, capacités de représentations
internes, capacités de différenciation et d’intégration,
capacité d’auto-observation, sens moral) sont très
légèrement modifiées pour tenir compte de l’acquisition
progressive des capacités de fonctionnement en fonction de l’âge.
Les difficultés et limitations par rapport à ces dimensions sont
présentées selon une échelle (de MCA 201 à MCA
208) : degré de flexibilité et d’intégrité optimal ;
degré raisonnable ; conflits transitoires liés au développement ;
constriction et inflexibilité légères, avec des
formations caractérielles ou symptomatiques encapsulées ;
constrictions et altérations du fonctionnement modérées ;
constrictions et altérations majeures ; défauts de l’intégration,
de l’organisation et/ou de la différentiation des représentations
du self et de l’objet ; défauts majeurs dans les fonctions
mentales de base. L’ensemble constitue un progrès par rapport à ce
que propose le DSM, mais reste très en deçà de ce
que propose l’OPD. On a pourtant le sentiment que des indications sur
l’engagement possible dans un processus thérapeutique, ou même
sur les différents vécus idiosyncrasiques (indépendamment
des symptômes) aurait été possible.
En ce qui concerne les patterns et troubles de la personnalité de l’enfant
et de l’adolescent (PCA), quinze catégories sont retenues au total :
craintif (schizoïde) ; soupçonneux (paranoïde) ;
sociopathique ; narcissique ; impulsif-explosif ; autodestructeur ;
dépressif ; somatisant (c’est-à-dire hypocondriaque) ;
dépendant ; évitant, contraphobique ; anxieux ;
obsessionnel-compulsif ; histrionique ; dérégulé ;
mixte. Ces catégories sont présentées comme susceptibles
de préfigurer les 24 types de personnalités propres aux adultes.
Six sont totalement absentes du DSM (impulsif-explosif ; autodestructeur ;
dépressif ; contraphobique ; somatisant ; dérégulé)
et une catégorie du DSM n’est pas reprise (personnalité schizotypique),
ce qui représente des modifications considérables. Cette proportion
donne la mesure des efforts faits par les auteurs pour se libérer d’une
vision trop linéaire de la psychopathologie. Néanmoins, on peut
se demander si ces efforts, transformant de façon intéressante en « patterns
et troubles de la personnalité » ce que le DSM appelait « troubles
de la personnalité et retard mental », ne restent pas un
peu timides. Certes, il est courageusement affirmé que troubles,
patterns, voire style personnel sont à situer dans une continuité,
néanmoins, peu d’effort est fait pour encourager le clinicien à donner
quelque consistance à la chose. Rappelons qu’originellement,
les « troubles de la personnalité » sont la version états-unienne
des « types de caractère » décrits par S
Freud, union de motifs inconscients et de défenses caractérielles ;
c’est actuellement tout ce qui reste de l’inconscient freudien
outre-atlantique.
En ce qui concerne les patterns de symptômes et l’expérience
subjective des enfants et des adolescents, il s’agit d’un axe qui,
comme chez l’adulte, ne modifie guère les catégories du
DSM, sauf sur deux points :
- trois entités sont ajoutées, les troubles visuo-spatiaux, les
troubles des fonctions exécutives et la tendance au suicide (suicidality).
- Un effort de classification est fait pour ordonnancer les symptômes
en huit groupes : 1) réponses de bonne qualité à des
crises développementales ou situationnelles ; 2) troubles des affects
(affects anxieux/humeur) ; 3) troubles disruptifs (où curieusement
l’abus de toxiques est intégré sans explication claire) ;
4) troubles réactifs ; 5) troubles du fonctionnement mental, très
vaste catégorie comprenant les troubles moteurs, les tics, les psychoses,
les troubles neuropsychologiques (troubles visuo-spatiaux, les troubles de
l’élaboration langagière et auditive, troubles de la mémoire,
troubles de l’attention/hyperactivité, arriérations) et
les troubles de l’apprentissage ; 6) les troubles psychophysiologiques
(anorexie et boulimie) ; 7) la très vaste catégorie des troubles
du développement (troubles de la régulation ; anorexie précoce ;
troubles de l’élimination ; troubles du sommeil ; troubles
de l’attachement ; troubles envahissants du développement) ;
et finalement 8) les troubles d’identité de genre.
On ne peut pas dire que le résultat soit ici enthousiasmant. A côté d’efforts
intéressants pour mieux situer le sens de crises et traumas vécus
par l’enfant, et de tentatives timides pour comprendre le « vécu
du symptôme », on voit se maintenir sans proposition de solution
un certain nombre de catégories problématiques propres au domaine états-unien :
u les troubles de l’attention-hyperactivité ne sont toujours pas
mieux caractérisés, ils incluent toujours des formes de symptomatologies
disparates (y compris anxieuses, malgré l’ICD 10), aucun effort
n’est fait pour faire le point des recherches à ce propos (et
notamment relativiser les « données neurologiques »,
toujours très hypothétiques), aucune critique des médications
proposées localement en première intention n’est esquissée.
- les troubles envahissants du développement sont toujours isolés
artificiellement des troubles psychotiques, et se retrouvent voisiner, sans
explication, l’énurésie /encoprésie et les troubles
de l’attachement … alors même que les enfants autistes sont
réputés ne pas avoir de troubles de l’attachement !
- Les troubles bipolaires de l’enfant sont d’un côté présentés
sans aucune critique alors même que ce diagnostic fait l’objet
de débats intenses ; ils sont d’un autre côté présentés
comme entièrement déconnectés des troubles psychotiques,
alors même que les médications antipsychotiques sont maintenant
la règle aux USA dans ces cas.
- L’abus de drogues est classé arbitrairement dans les troubles
des comportements disruptifs, alors même que les auteurs notent la multiplicité des
problématiques sous-jacentes possibles.
Un chapitre est consacré à la classification des troubles de
la santé mentale chez le bébé et le jeune enfant (axe
IEC, qui est en fait …multi-axial). S.I. Greenspan y
propose d’envisager trois grandes catégories : les troubles
interactifs (ID) ; les troubles de l’élaboration de la régulation
sensorielle (RSPD); les troubles neurodéveloppementaux de la relation
et de la communication (NDRC). Il est proposé une évaluation à partir
de quatre axes :
1. capacités fonctionnelles, émotionnelles et développementales,
selon une succession de phases de développement :attention et régulation
conjointes de 0 à 3 mois ; engagement et relation de 3 à 6
mois ; signaux intentionnels affectifs et communicationnels bilatéraux
(6-9mois) ; chaînes de signaux co-régulés et solution
de problèmes conjointe (9-18 mois) ; création de représentations
(18-30 mois ; création de ponts entre les pensées et pensée
logique (30-48 mois) ;
2. capacités d’élaboration régulatoires et sensorielles ;
3. patterns entre enfant et parent ;
4. autres diagnostics médicaux et neurologiques.
S.I. Greenspan distingue alors 16 types de troubles interactifs,
7 types de patterns d’élaboration de la régulation sensorielle,
et quatre niveaux de troubles neurodéveloppementaux.
L’ensemble (qui reprend la logique de l’ICDL-DMIC, du même
auteur) donne une impression de grande complexité, et semble davantage
approprié à la recherche sur des processus de socialisation qu’à une
approche minutieuse des vécus de l’enfant, même si Mme Greenspan
s’est illustrée précédemment par une théorie émotionnelle
de la génèse de l’autisme (« affect diathesis
hypothesis »). Il vise bien entendu à élaborer
des précurseurs des troubles infantiles tels que décrits dans
le chapitre précédent.
En résumé, la partie « enfant et adolescent » du
PDM constitue une contribution intéressante par rapport au DSM-TR, sur
des sujets d’une actualité brûlante ; on peut néanmoins
craindre que cette contribution soit un peu trop timide par rapport à ce
qui apparaîtrait souhaitable pour réformer de façon convaincante
les pratiques locales de soins psychiques.
François Sauvagnat est professeur de psychologie à l’Université de
Rennes-II (psychopathologie)f.sauvagnat@wanadoo.fr
La recherche dans le Psychodynamic Diagnostic Manual : Un champ en activité.
Jean-Michel Thurin
Précédée de quatre chapitres consacrés aux Fondements conceptuels et historiques, la partie Fondements issus de la recherche du MDP représente plus de 300 pages sur les 857 de l’ouvrage, ce qui montre l’importance attribuée à ce domaine par les auteurs et la dynamique des travaux qui l’alimentent. Cette présentation comporte huit chapitres* centrés sur l’histoire, les questions méthodologiques et les résultats des recherches évaluatives en psychothérapies psychanalytiques.
R Wallerstein distingue quatre générations de recherches psychanalytiques. La première commence en 1917 et s’étend sur la première moitié du siècle. Elle consiste en de simples énumérations rétrospectives de pourcentages de résultats d’amélioration (selon des critères non spécifiés) rassemblés par des praticiens ou par des centres de traitement dans les premiers instituts psychanalytiques. La seconde génération (1959-1984) cherche à surpasser la simplicité méthodologique flagrante de la précédente. Les études sont organisées suivant deux modalités : prospectives, agrégées en groupes, utilisant des définitions spécifiées, des critères opérationnalisés et des prédictions de résultats attendus ; individuelles systématiques sur une série de patients. La troisième génération (1954-1986) est contemporaine de la précédente. Les deux types d’études sont combinés. L’objectif est à la fois d’évaluer les résultats d’un nombre significatif de cas et d’examiner comment ces résultats sont atteints à partir d’une étude longitudinale intensive de chaque cas. Par ailleurs, les résultats à la terminaison du traitement sont distingués de ceux du suivi, et les changements dans cette « phase post-analytique » sont analysés. La quatrième et actuelle génération d’études comprend des études de processus détaillées. Les programmes sont habituellement fabriqués pour combiner les différentes études de processus avec les mesures de résultats établies. Le but est de réaliser une représentation théorique et opérationnelle, dans des termes proches, du fonctionnement et du caractère du patient, du processus de traitement et des résultats obtenus.
Blatt et al. démontrent que le résultat d’une psychothérapie dépend, pour une part très importante, de l’aptitude du thérapeute à apprécier l’organisation et la structure de la personnalité de son patient. Selon leurmodèle, cette organisation s’établit à partir de deux lignes fondamentales de développement. La première, relationnelle ou anaclitique, structure la capacité d’établir des relations interpersonnelles de plus en plus matures et mutuellement satisfaisantes ; la seconde, de définition de soi ou introjective, structure le développement d’une identité consolidée, réaliste, essentiellement positive, différentiée et intégrée. Dans une perspective favorable, les deux lignes évoluent au cours de la vie suivant une transaction réciproque ou dialectique qui permet à l’une et l’autre de se développer. Dans une perspective défavorable, elles donnent naissance à des personnalités plus ou moins pathologiques, qui contribuent au développement de troubles. Des troubles d’expression symptomatique semblable peuvent être ainsi très différents dans leur nature. C’est le cas de la dépression anaclitique centrée sur des sentiments de solitude, d’abandon et de négligence, et de la dépression introjective centrée sur des questions de valeur de soi, des sentiments d’échec et de honte. Partant de populations constituées pour différentes études (Riggs-Yale Project, Projet de recherche de la clinique Menninger, Programme collaboratif sur la dépression), les auteurs ont étudié la variation des résultats en fonction de trois variables : le type de personnalité anaclitique ou introjectif (à partir de formulations cliniques étendues de cas, et d instruments tels que le Rorschach et le TAT), l’alliance thérapeutique et la modalité d’approche psychothérapique. Les variations observées ont permis de différencier les approches qui marchent de celles qui ne marchent pas en fonction de la personnalité du patient, du problème central de son développement auquel sa personnalité/pathologie est liée et bien entendu de l’ajustement du thérapeute à cette configuration.
Shedler et Westen présentent la SWAP,
une procédure d’évaluation dimensionnelle du changement
portant sur la structure de la personnalité en psychothérapie.
Cet instrument fonctionne sur le principe d’une série de propositions
descriptives de traits de personnalité auxquelles l’utilisateur
attribue un score de 0 à 7 en fonction de leur adéquation avec
l’appréciation clinique du patient. Il peut être appliqué à toutes
les psychothérapies, quelle que soit leur approche et est destiné à être
utilisé par les cliniciens qui souhaitent évaluer les évolutions
de structure susceptibles d’accompagner une psychothérapie. L’exemple
qui est présenté montre l’évolution du profil des
traits de personnalité dans les dix troubles de l’axe II chez
une jeune patiente au début et à deux ans de traitement. Cette évolution
apparaît dans la comparaison des deux courbes qui récapitulent
les scores pour chacun des « troubles » devenus axes
de personnalité. Pour maintenir la continuité de l’approche
dimensionnelle de la SWAP avec le système catégoriel du DSM,
le score de 60 est suggéré comme point d’équivalence
avec le diagnostic de trouble de la personnalité et celui de 55 pour
celui de « traits ». Une échelle de « fonctionnement
sain » de la personnalité est adjointe. La comparaison des
deux courbes montre que la patiente n’est plus « borderline
avec traits antisociaux et histrioniques » comme au départ,
mais que ses scores les plus hauts se situent plutôt dans le registre
obsessionnel sans atteindre un seuil de traits ou de trouble. L’aspect
dynamique et dimentionnel de l’organisaation de la personnalité apparaît
ainsi clairement. La SWAP a bénéficié de la collaboration
de centaines de cliniciens, psychiatres et psychologues et les résultats
de validité soutiennent la possibilité de développer
une classification dimensionnelle des troubles de la personnalité et
de produire un « langage » de description des cas à la
fois riche cliniquement et empiriquement rigoureux. La SWAP peut être
testée sur Internet à l’adresse suivante : http://www.swapassessment.com/
Dahlbender et al. présentent
l’axe IV, brièvement nommé « structure psychique »,
du système des Diagnostics Psychodynamiques Opérationnalisés
(OPD). L’OPD est une approche psychodynamique multiaxiale opérationnalisée
basée sur quatre axes : « expérience de la maladie
et conditions préalables pour le traitement », « relations
interpersonnelles », « conflits » et « structure
psychique ». Il s’y ajoute un cinquième axe « troubles
psychiques et psychosomatiques » qui permet au diagnostic OPD d’être
mis en relation avec les classifications descriptives CIM et DSM. L’objectif
de l’OPD est de proposer un complément majeur à la CIM
et au DSM dont la focalisation sur les symptômes de surface conduit à négliger
des aspects de la psychopathologie essentiels pour la préparation et
la direction du traitement psychothérapique. La structure psychique
et le fonctionnement mental forment ainsi un concept central du diagnostic,
aux côtés des configurations interpersonnelles et des conflits.
Se constituant au cours de l’enfance précoce, leur fonctionnement à l’âge
adulte apporte également une perspective développementale au
diagnostic. L’évaluation se fait suivant six dimensions recouvrant
24 sous-dimensions qui peuvent être détectées dans les
interactions présentes et passées, en particulier avec le thérapeute.
- Perception de soi : réflexion sur soi, image
de soi, identité, différenciation des affects.
- Régulation de soi : tolérance des affects,
estime de soi, régulation des pulsions instinctuelles, anticipation.
- Défenses : type, résultat, stabilité,
flexibilité des mécanismes de défense.
- Perception de l’objet ; différenciation
sujet-objet, empathie, perception de l’objet comme un tout, affects concernant
l’objet.
- Communication : contact, compréhension des affects
des autres, communication de ses propres affecs, réciprocité.
- Lien (Attachement) : internalisation, détachement,
variabilité de l’attachement.
Le manuel de la présentation développée de l’axe
IV et sa passation est intégralement reproduit dans ce chapitre.
Westen, Novotny et Thomson-Brenner présentent une analyse
critique extrêmement détaillée de la base scientifique
des « thérapies validées empiriquement » (ESTs) et
proposent des méthodologies alternatives lorsque les hypothèses
sous-jacentes à la méthodologie EST ne sont pas valides. Ils
suggèrent que la recherche expérimentale se déplace sur
les stratégies d’intervention et les théories du changement,
aspects essentiels que les cliniciens pourront intégrer dans les thérapies informées empiriquement.
Ce texte, initialement publié dans le Psychological Bulletin a
suscité un grand débat par publications interposées sur
le statut empirique des psychothérapies soutenues empiriquement. Plusieurs
auteurs très renommés, dont Ablon, Goldfried, Crits-Christoph et Weisz y
ont participé. L’ensemble permet de bien comprendre les différents
arguments.
P Fonagy s’est beaucoup impliqué dans les recherches expérimentales d’efficacité des psychothérapies partant des classifications traditionnelles DSM que le MDP s’est donné pour objectif de transcender. Une partie de son texte présente donc l’actualité des résultats des recherches portant sur les psychothérapies psychanalytiques menées dans le cadre du schéma DSM depuis 10 ans. Cette revue porte essentiellement sur les psychothérapies brèves. Nous renvoyons sur cette question aux chapitres 5 et 6 de l’expertise collective Inserm et à sa mise à jour sur techniques psychothérapiques : http://www.techniques-psychotherapiques.org/resultats/
Mais une autre partie concerne sa vision de l’évolution de la
recherche. Elle peut se résumer ainsi : la preuve fondée
sur la pratique est aujourd’hui nécessaire pour établir
de façon complète une pratique basée sur la preuve.
Quel serait le programme de recherche idéal ? Se référant à Kazdin (1998),
il propose de partir d’une analyse fonctionnelle du trouble et de sa
dynamique pour construire une approche thérapeutique qui lui soit cohérente.
Cette approche sera conceptualisée et spécifiée, testée
de façon globale, puis à partir des processus de traitement et
ce qui les affecte. Les corrélations trouvées seront seulement
alors complétées par des études expérimentales.
Enfin, le champ d’application du traitement sera établi en relation
aux caractéristiques du patient et de son environnement. On remarquera
que cette approche constitue un véritable renversement de la perspective
classique. Sa mise en œuvre s’appuie sur des études pragmatiques
(quasi-expérimentales) se déroulant dans le champ clinique et
portant sur des questions que les cliniciens se posent dans leur pratique.
Cette série de chapitres se termine par une revue des méta-analyses
d’études de résultats de la psychothérapie psychodynamique
par Leichsenring. Après avoir rappelé la nécessité d’une
réévaluation des rôles respectifs des études expérimentales
(ECRs) et des études naturalistes, il résume sa revue méta-analytique
de 2001 sur la dépression en discutant au passage la critique qu’en
a faite Fonagy, ce qui montre que les discussions ne concernent
pas que des groupes d’orientation théorique différente,
puis celle de 2003 concernant les troubles de la personnalité. Dans
sa discussion, il insiste sur les difficultés de comparaison des psychothérapies « globales » étant
donnée la variabilité entre cliniciens de leur application et
l’absence de définition précise sur des ingrédients
qui définissent les différentes approches, jusqu’aux travaux
de Ablon, Jones, Blagys et Hilsenroth. Sa
conclusion porte sur la nécessité de travaux portant sur les
psychothérapies psychodynamiques longues pour lesquelles les protocoles
d’ECRs sont difficilement appropriés.
* 1) Histoire de la recherche sur la thérapie
psychanalytique (R Wallerstein) ; 2) Évaluer l’efficacité potentielle,
réelle et les facteurs de changement dans les psychothérapies
psychodynamiques (S. J. Blatt, J. S. Auerbach, D. C. Zuroff, and G. Shahar.) ; 3) Diagnostic
de personnalité à partir de la SWAP (J Schedler et D Westen) ; 4) Diagnostics
de structure psychique et de fonctionnement mental à partir de l’OPD
(R. Dahlbender, G. Rudolf, et le groupe opérationnel de l’OPD) ; 5) Panorama
de la base empirique de l’approche DSM basée sur le symptôme à la
classification diagnostique (A Herzig et J Licht) ; 6) Statut
empirique des psychothérapies soutenues empiriquement : présupposés,
résultats et rapports dans les ECRs (D Westen, C Novotny et H Thompson-Brenner) ; 7) Psychothérapies
psychodynamiques fondées sur la preuve (P Fonagy) et 8) Revue
des méta-analyses d’études de résultat de la psychothérapie
psychodynamique (F Leichsenring)
Jean-Michel Thurin jmthurin@internet-medical.com
Le PDM est présenté sur Internet : http://www.techniques-psychotherapiques.org/Documentation/Ouvrages/MDP/default.html
*****
Médecin, neurologue et pharmacologue, Hervé Allain rejoignit
très tôt, alors qu’il était encore interne, le Laboratoire
de Pharmacologie de la Faculté de Médecine de Rennes, alors dirigé par
le Professeur Jean Van Den Driessche. Il contribua avec énergie et enthousiasme à développer
un axe de recherche en neuropsychopharmacologie, tant fondamentale que clinique,
en particulier dans les domaines des médicaments des maladies neuro-dégénératives,
maladie de Parkinson puis maladie d’Alzheimer. C’était aussi le Directeur du Centre Mémoire Ressources
Recherche et du Centre de PharmacoVigilance de Rennes, cherchant à confronter
les données expérimentales ou de notification spontanée
aux approches pharmacoépidémiologiques, pharmacogénétiques
et de Pharmacologie Sociale qui le fascinaient. Il était également
membre de multiples sociétés savantes, de comités et conseils
scientifiques ou d’administration. Il était consultant pour des
laboratoires pharmaceutiques et expert auprès des Agences française
et européenne du médicament. Hervé était passionné d’idées
et de technologies nouvelles. Chaleureux, il aimait communiquer avec ses collaborateurs
proches ou aux quatre coins de la planète. ***** Hommage à Hervé ALLAIN
 Il va nous manquer ! Les lecteurs de Pour la Recherche connaissent
bien Hervé Allain. Il nous a quitté récemment et c’est
une grande tristesse. Scientifiquement ouvert et humainement disponible, il était
toujours prêt à réfléchir à un sujet proposé.
Il avait la plume rigoureuse et critique sans oublier à chaque fois
une note d’humour qu’il savait fort bien manier. « Bonjour
les amis » disait-il lorsqu’il poussait la porte en montrant
un visage souriant. C’est celui que nous gardons dans notre esprit en
pensant à lui.
Il va nous manquer ! Les lecteurs de Pour la Recherche connaissent
bien Hervé Allain. Il nous a quitté récemment et c’est
une grande tristesse. Scientifiquement ouvert et humainement disponible, il était
toujours prêt à réfléchir à un sujet proposé.
Il avait la plume rigoureuse et critique sans oublier à chaque fois
une note d’humour qu’il savait fort bien manier. « Bonjour
les amis » disait-il lorsqu’il poussait la porte en montrant
un visage souriant. C’est celui que nous gardons dans notre esprit en
pensant à lui.
Le Professeur Allain était devenu le référent français
en matière de Pharmacologie Expérimentale et Clinique des médicaments
des troubles démentiels. Il était l’auteur d’un grand
nombre de publications de recherche dans ces domaines mais aussi de nombreux
articles d’information scientifique et de chapitres de livres. Sa notoriété était
internationale et il était invité à donner des conférences
dans le monde entier. L’activité débordante d’Hervé était
plurielle. En parallèle de sa charge de chef de service du laboratoire
hospitalo-universitaire de pharmacologie, enseignant, chercheur, clinicien,
il fut le concepteur et créateur d’un des premiers centres français
de Pharmacologie Clinique chez le volontaire sain, Biotrial.
Marié, il était père de quatre enfants. Il n’avait
que 56 ans.
| Accueil PLR | |