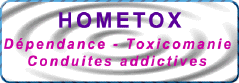|
�
DROGUES DE SYNTHESE
EMPATHOGENES, DESIGNER DRUGS
Les nouvelles
mol�cules entactog�nes, se retrouvent parmi les m�diateurs directs de
la transformation socio-culturelle enregistr�e depuis quelques ann�es
dans la consommation de substances psychotropes.
La recherche de l�empathie
(la capacit� � aller vers l�autre sans barri�re ou limite), analys�e
dans le contexte de la "�soci�t� de
d�sinhibition�", souligne le manque de communication avec l�Autre,
le manque de confiance en soi, la perte de rep�res stables mais surtout
une crise de la repr�sentation sociale. Il suffit d�analyser l�av�nement
de nouvelles mol�cules - certaines � usage m�dical, certaines � usage
d�tourn� � mol�cules r�put�es capables de r�soudre compl�tement
ou presque les probl�mes de la vie courante, pour imaginer une soci�t�
en perte de vitesse, en pleine mutation sociologique.
Comme le souligne
Alain Ehrenberg, le "�culte de la performance�"
(performance individuelle et capacit� d�adaptabilit�), deviennent les
valeurs s�res, recherch�es assid�ment par les membres de la soci�t�
[2, 5]. Le recours � ces g�lules de la performance - m�dicaments
d�tourn�s de leur usage ou des substances psychoactives illicites - est
accept� et valoris� par les membres des petits groupes de consommateurs.
L�individu confront� aux probl�mes et aux contradictions insolubles de
la vie courante �chappe aux r�gulations sociales. Le manque de
communication r�elle et le sentiment de non-reconnaissance ressentis par
les plus jeunes membres de la soci�t�, am�nent une recherche de
"�b�quilles chimiques�", v�ritables supports
artificiels cens�s r�soudre les probl�mes de la vie courante.
Du point de vue
des �thno-sociologues, la prise de substances psychoactives pendant les
soir�es "�raves�" serait impr�gn�e d�une image
rituelle comme dans les initiations religieuses traditionnelles. L��tat
de transe am�ne la n�gation d�une culture jug�e d�pass�e. Les
valeurs culturelles de la soci�t� "�bien pensante�",
g�n�ralement accept�es, ont perdu leur v�racit�. La r�surgence des
valeurs culturelles des ann�es soixante, dont le souvenir fait �tat de
chaleur humaine et d��changes spirituels, du "�d�veloppement
personnel�" et du renforcement de l�ego, constitue un cadre
propice � l�utilisation des drogues synth�tiques [6, 8].
Jusqu��
pr�sent, les sp�cialistes se sont pench� simplement sur le ph�nom�ne
"�XTC�". Du fait du large retentissement m�diatique
de l�ecstasy (MDMA), on avait tendance � trop focaliser sur ce produit.
L�interdiction de l�ecstasy, son inscription sur la liste de
substances prohib�e, ont pourtant amen� les chimistes � synth�tiser d�autres
types de mol�cules similaires. On les appelle drogues analogues et on les
retrouve dans des boutiques sp�cialis�es ("�smart
shops�") � Londres ou Amsterdam, dans des soir�es raves, sur
les pages internet des chistes confirm�s ou de fortune. C�est ce
ph�nom�ne que ce court expos� s�efforce de mettre en �vidence.
Un bref aper�u
des donn�es actuelles concernant l�ecstasy est n�cessaire. Les
donn�es obtenues par les chercheurs fran�ais (Delile et Ingold),
permettent de "�tirer�" le portrait d�un usager d�ecstasy.
D�apr�s ces deux �tudes, le consommateur d�ecstasy est repr�sent�
majoritairement (2/3 des cas) par des hommes jeunes ayant atteint un
niveau d'�tude �lev� (65% ont le Bac, 25% suivent des �tudes
sup�rieures). De m�me, leur niveau �lev� de protection sociale, leur
activit� professionnelle fr�quente, leurs conditions de logement et la
raret� de leurs ant�c�dents judiciaires, t�moignent d'un bon niveau
d'insertion qui les rapproche beaucoup plus de la population g�n�rale du
m�me �ge que de celle des toxicomanes. La plupart des jeunes (90% selon
Delile), ont d�j� pris du cannabis, et certains du LSD et de la
coca�ne. L'ecstasy est g�n�ralement consomm� en association avec
d'autres produits. Il n'est que tr�s exceptionnellement le premier
produit illicite rencontr� par les sujets.
Ce qui semble
inqui�tant � dans une d�marche pr�ventive et de r�duction de risque
� est le faible pourcentage de jeunes inform�s par les enseignants. La
grande majorit� dispose des informations provenant presque toujours
d'amis (91%) ou d'usagers (66%). A l'issue de leur premi�re
exp�rimentation, 24% des sujets ont arr�t� tout usage d'ecstasy mais
dans la majorit� des cas ont continu� � utiliser d'autres produits.
Parmi ceux qui ont poursuivi leur consommation d'ecstasy, si le quart se
disent usagers occasionnels, plus du tiers en consomment une fois par
semaine et certains quotidiennement (3,2%). L�usage r�gulier devient
solitaire (environ 30% de sujets).
Chose importante,
plus de la moiti� des sujets mentionnent des probl�mes de sant� li�s
� l'usage d'ecstasy : des probl�mes physiques et psychiques dans 38% des
cas, des probl�mes psychiques uniquement dans 19% des cas (mais certains
tr�s aigus), des probl�mes physiques uniquement dans 10% des cas.
De plus en plus,
les saisies douani�res et pendant les soir�es raves, mettent en
�vidence l�existence de comprim�s vendus sous le nom d�ecstasy, mais
qui ont un tr�s faible contenu en MDMA. La plupart de produits chimiques
qui composent ces mol�cules sont des amph�tamines like (MBDB, MDEA,
amph�tamine) voire de la caf�ine, Lexomil, atropine. Parmi les produits
m�lang�s on retrouve ces nouvelles drogues synth�tiques (GHB, 2 CB)
CONCLUSIONS
Dans ce contexte de d�tresse sociale, le d�veloppement des drogues
empathog�nes offre une "�solution�" � tous ces maux
de la soci�t�. Gages de performance et d�adaptabilit�, ces substances
� m�dicaments psychotropes ou "�uppers�" (coca�ne,
amph�tamines) � sont de plus en plus employ�es et mises en �vidence.
Les drogues de synth�se favorisent l�empathie, favorise le
rapprochement entre des gens en mal de communication et de vivre. La
facilit� de synth�se de ces produits, le d�ni de leur nocivit�, l�image
des "�drogues qui sont pas de la drogue�", le bonheur
chimique qu�elles engendrent, sont des facteurs incitants � la
consommation de ces nouvelles drogues. |